Maison Dandoy fait rimer tradition avec innovation et repense son modèle économique pour concilier pérennité de l’entreprise et respect des limites planétaires.Maison Dandoy incarne bien plus qu’une enseigne de biscuits à Bruxelles. Elle est l’un de ces repères...

Modèles économiques robustes : s’inspirer du vivant pour faire face aux crises
Face aux crises à répétition, nos modèles économiques atteignent leurs limites. La performance et l’optimisation à tout prix ne sont plus viables. L’heure est au changement : coopération, diversification et gestion des ressources sont essentiels pour dessiner de nouveaux modèles économiques capables de résister aux fluctuations.
Dans un monde où tout va vite, la performance et l’optimisation sont vues comme les clés du succès, et les hommes d’affaire super-performants comme des icônes. Atteindre ses objectifs le plus rapidement possible avec le moins de moyens possible, telle est la quête de notre société actuelle.
Olivier Hamant, biologiste et chercheur à l’INRAE, s’inspire, lui, du vivant et propose un changement total de paradigme : la vraie clé, c’est la robustesse. Revenons sur ses propos.
La robustesse, c’est quoi ?
C’est assez simple à comprendre : être robuste, c’est rester stable malgré les fluctuations (les crises, les changements importants).
Contrairement à la résilience qui consiste à revenir à son état initial après un choc, la robustesse, c’est absorber le choc et avancer malgré tout. C’est donc apprendre à encaisser sans tomber plutôt que se relever.
« La résilience c’est se relever après avoir subi un choc.
La robustesse c’est apprendre à encaisser ce choc sans tomber »
La performance a ses limites
Aujourd’hui, tout est optimisé au nom de la performance : coûts, process, profits, … Mais un système trop optimisé atteint plus rapidement ses limites.
Really ?
Oui. Petit flashback sur le blocage du canal de Suez en 2021 pour illustrer ce propos… Le 23 mars 2021, un porte-conteneur géant d’Evergreen s’échoue en plein canal de Suez à cause des mauvaises conditions météorologiques, bloquant complètement le passage dans les 2 sens pendant 6 jours. Cette année-là, c’est 12% du commerce mondial qui transite par ce canal et, selon l’assureur Allianz, les pertes financières s’élèvent de 6 à 10 milliards de dollars par jour de blocage.
Cet incident révèle que le modèle de commerce maritime mondial basé sur l’hyper-optimisation et le gigantisme est vulnérable et ne tient pas la route en cas de crise.
Mais la contre-performance a mauvaise presse. On nous a éduqué à la compétitivité, et ça ferait mauvais genre de ne pas viser d’être le ou la meilleure. Les figures super-performantes érigées au statut de maîtres de l’optimisation continuent d’être glorifiées et accèdent à toujours plus de pouvoir. Ils nous promettent la lune (ou Mars 😉) et enchaînent les succès en serrant les boulons au maximum. Sauf que les systèmes qu’ils proposent sont vulnérables à l’image de la crise du canal de Suez, et, quand ça craque, ce sont eux qui tombent en premier.
La contre-performance est nécessaire à notre robustesse. Olivier Hamant prend comme exemple la pause-café. Sur le papier, c’est du temps perdu. En réalité, c’est un moment où les idées fusent, où la coopération se tisse, où l’organisation devient plus robuste. Un ralentissement qui, paradoxalement, booste l’ensemble.
Autre exemple avec la gestion de l’approvisionnement. Lorsqu’une société diversifie ses fournisseurs, elle renonce aux réductions obtenues sur les grosses quantités commandées. Ses coûts d’approvisionnement augmentent. Ça va à l’encontre des principes d’économie d’échelle. Cependant, si l’un des fournisseurs disparait du jour au lendemain, l’activité sera à peine ébranlée.
À retenir : Les marges de sécurité sont contre-performantes mais elles permettent au système d’être robuste face aux crises qu’il pourrait rencontrer.
Un système qui bascule
Olivier Hamant le dit sans détour : « l’excès de contrôle nous fera perdre le contrôle ».
Les crises actuelles nous le rappellent : l’optimisation aveugle nous a conduits à une fragilité systémique. Le changement climatique provoque des famines, des problèmes logistiques, des incendies, des déplacements massifs de populations… Et si nos modèles économiques peinent à encaisser, c’est parce qu’ils ont été conçus pour un monde stable et prédictible. Tout cela met en évidence une réalité : nous devons repenser nos modèles économiques en tenant compte de notre monde fluctuant et incertain. Et il est temps de s’inspirer de ce que les autres êtres vivants (non humains) font pour résister aux fluctuations de leur environnement.
Observons un arbre. Il ne pousse pas en flux tendu, il ne cherche pas l’optimisation de chaque goutte d’eau ou chaque rayon de soleil capté pour grandir plus vite et être plus beau. Non, il stocke. Il accumule des ressources dans ses racines, dans son tronc, et il n’y touche qu’en cas de besoin : sécheresse, maladie, hiver rude… Son secret ? Une gestion prudente des ressources, qui lui permet d’encaisser les aléas sans flancher.
C’est exactement ce que nos entreprises et nos sociétés devraient viser. Arrêter de fonctionner à flux tendu, laisser de la place aux imprévus, prévoir des marges. Faire fi de la sacro-sainte loi de l’offre et de la demande qui repose sur l’idée que les échanges économiques sont rationnels et infinis mais qui omet une donnée fondamentale : la nature n’est ni gratuite, ni illimitée. La robustesse, c’est passer d’une logique « offre X demande » à une logique « besoins X ressources ».
Dans cette perspective, la nature devient un véritable partenaire, et non plus un simple stock à exploiter.
La biodiversité : le meilleur levier
La tendance actuelle est de faire le focus sur les problèmes de climat avec un indicateur clair : les émissions de CO2. C’est une erreur de notre part ! Réduire les émissions de CO2 est important, mais pas suffisant. On doit mettre le focus sur l’effondrement de la biodiversité.
Pourquoi ? En concentrant nos efforts sur la préservation de la biodiversité, on fera par la même occasion du bien au climat, aux ressources, etc. C’est le levier le plus systémique. De plus, ça ne coûte pas cher et on maîtrise déjà toutes les techniques (agroforesterie, agroécologie, permaculture, etc.)
Par ailleurs, plutôt que « décarboner » l’économie, il est nécessaire de la « décombustionner » (arrêter de brûler du carbone) et la recarboner intelligemment en remplaçant le pétrole et les métaux par des molécules biosourcées et biodégradables : en favorisant les ressources renouvelables, en utilisant des déchets organiques… bref, en produisant de la biomasse. Et cette biomasse doit servir 3 objectifs prioritaires dans cet ordre précis :
- Nourrir les services écosystémiques (la biodiversité) ;
- Garantir une alimentation pour tous ;
- Créer des biomatériaux
Et concrètement, on fait comment pour être robuste ?
Pour rester stable dans un milieu incertain, la première étape, c’est de se rendre adaptable. C’est-à-dire pousser à explorer tous les scénarios et à diversifier les solutions. Ça veut dire plus de polyvalence et d’inefficacité afin de mettre du jeu dans les rouages : diversifier ses activités, arrêter de dépendre d’un seul fournisseur, miser sur les circuits courts et l’économie circulaire et régénérative, … Autant de contre-performances qui augmentent la robustesse. C’est l’inverse de la spécialisation.
La gestion des ressources, élément-clé pour devenir robuste, remet en question notre rapport à propriété. On voit de plus en plus de modèles construits sur les principes de l’économie de la fonctionnalité. Plutôt que de vendre un produit, on propose son usage : c’est la voiture partagée plutôt que la voiture individuelle, l’impression facturée à la page plutôt que l’achat d’une imprimante. Résultat ? Une meilleure gestion des ressources et des modèles économiques qui tiennent sur la durée.
Ensuite, pour que tout ça fonctionne, il faut plus de coopération. A ne pas confondre avec collaboration. Collaborer, c’est avancer chacun sur son projet individuel en espérant que la somme des succès individuels sera positive pour le bien commun. Coopérer, c’est faire primer le bien commun sur ses objectifs individuels. C’est miser sur l’échange, le partage et la complémentarité. On ne joue plus en solo, mais en réseau. On ne s’appuie plus sur une abondance matérielle, mais sur une abondance d’interactions. Et spoiler : c’est précisément ce qui rend un système plus solide face aux secousses.
Un bon exemple ? La Maison Dandoy.
Cette biscuiterie bruxelloise (qui régale depuis 1829) a décidé d’arrêter d’exporter à l’autre bout du monde. Objectif : réduire son empreinte carbone et renforcer son ancrage local. Et ce n’est pas tout : elle fabrique désormais ses spéculoos avec de la farine issue à 100 % de l’agriculture régénérative. Ses virages assumés sont une manière de préserver la biodiversité et de stabiliser ses approvisionnements. Résultat ? Moins de dépendance aux fluctuations du marché, plus de solidité face aux crises. On dit bravo !
Le mot de la fin
Dans un monde où les crises s’enchaînent, la robustesse, ce n’est pas un luxe. C’est une nécessité. Miser dessus, c’est assurer un avenir plus stable, plus fiable, plus heureux. Et franchement, on dit oui !
Articles qui pourraient vous intéresser
Maison Dandoy : le choix du vivant
Modèles économiques robustes : s’inspirer du vivant pour faire face aux crises
Face aux crises à répétition, nos modèles économiques atteignent leurs limites. La performance et l’optimisation à tout prix ne sont plus viables. L’heure est au changement : coopération, diversification et gestion des ressources sont essentiels pour dessiner de...
Inspirer les jeunes à bâtir une Europe robuste et durable grâce à l’e-learning
Pour relever les défis sociétaux auxquels fait face l’Europe, former les jeunes à l’économie circulaire et l’entrepreneuriat durable est essentiel. Découvrez comment une formation en e-learning peut être intégrée aux cursus pour bâtir des futurs modèles économiques...







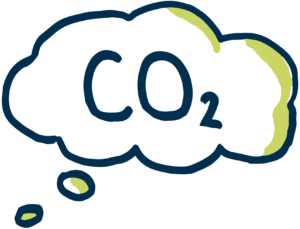


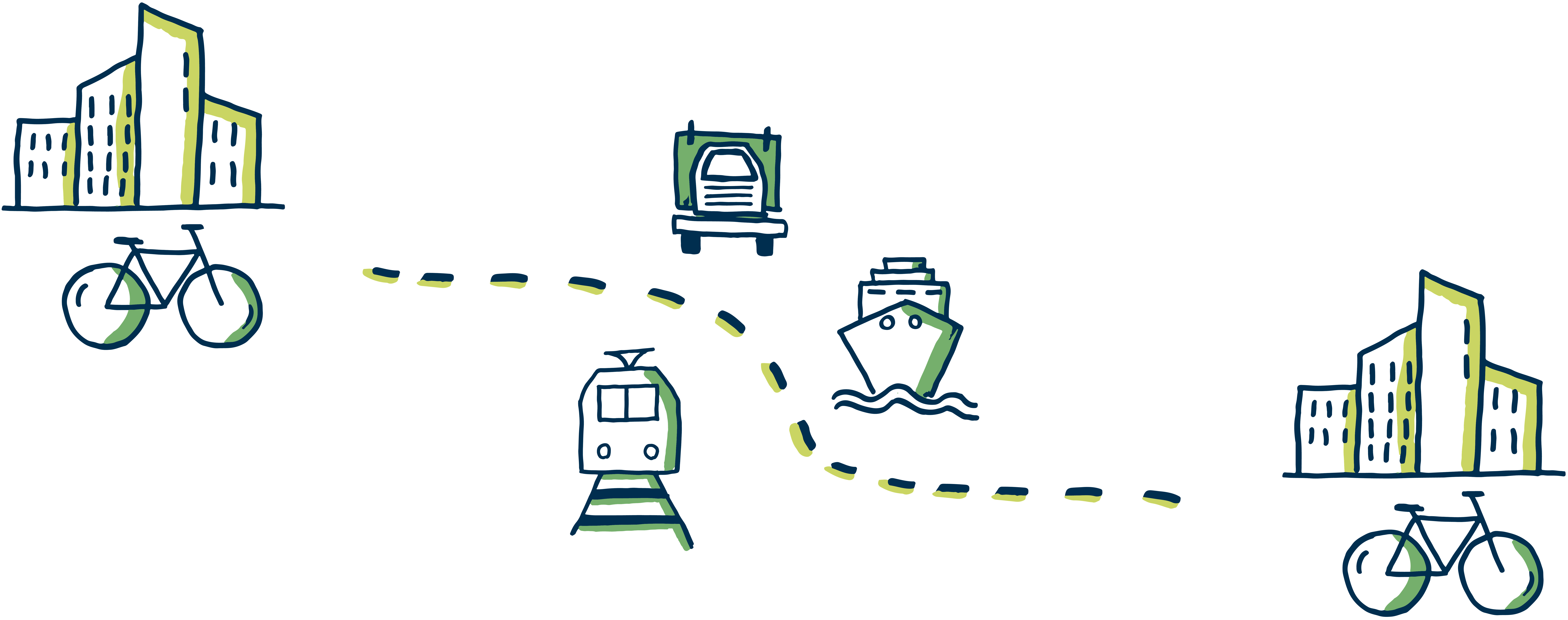







 Depuis quelques temps, nous voyons émerger des espaces ouverts à toutes et tous qui réinventent notre manière de vivre en société. Pouvant prendre différentes formes, ces espaces ont pour objectif commun de régénérer les territoires, relocaliser l’économie et créer du lien social.
Depuis quelques temps, nous voyons émerger des espaces ouverts à toutes et tous qui réinventent notre manière de vivre en société. Pouvant prendre différentes formes, ces espaces ont pour objectif commun de régénérer les territoires, relocaliser l’économie et créer du lien social. 
 Quelle aura été la participation de Groupe One au sein de ce projet ?
Quelle aura été la participation de Groupe One au sein de ce projet ?










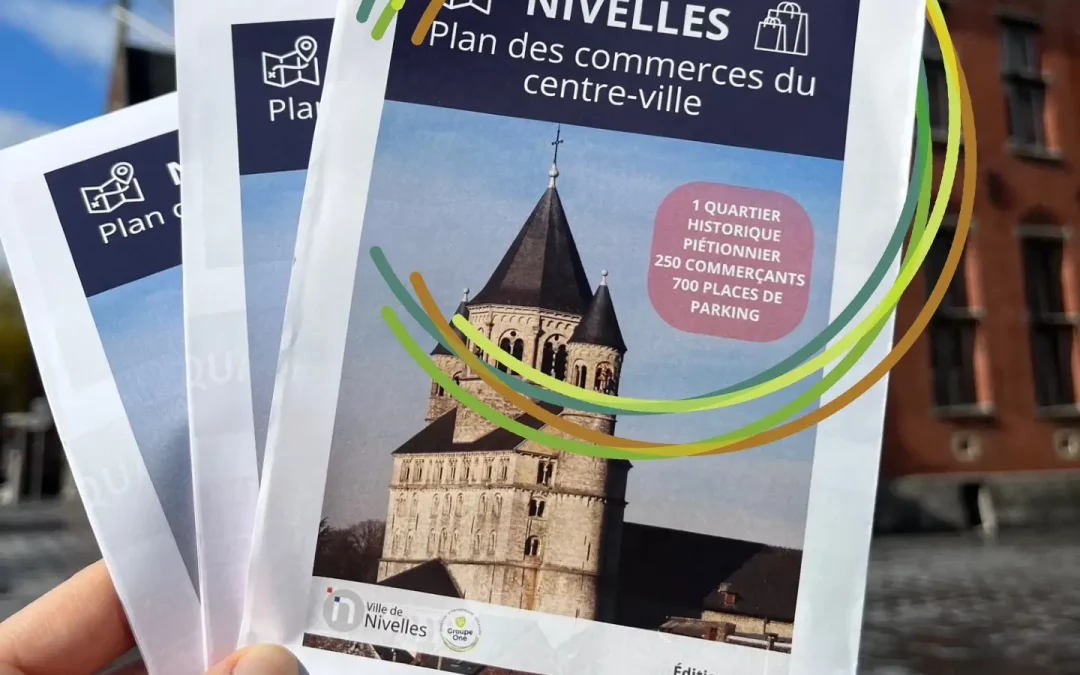
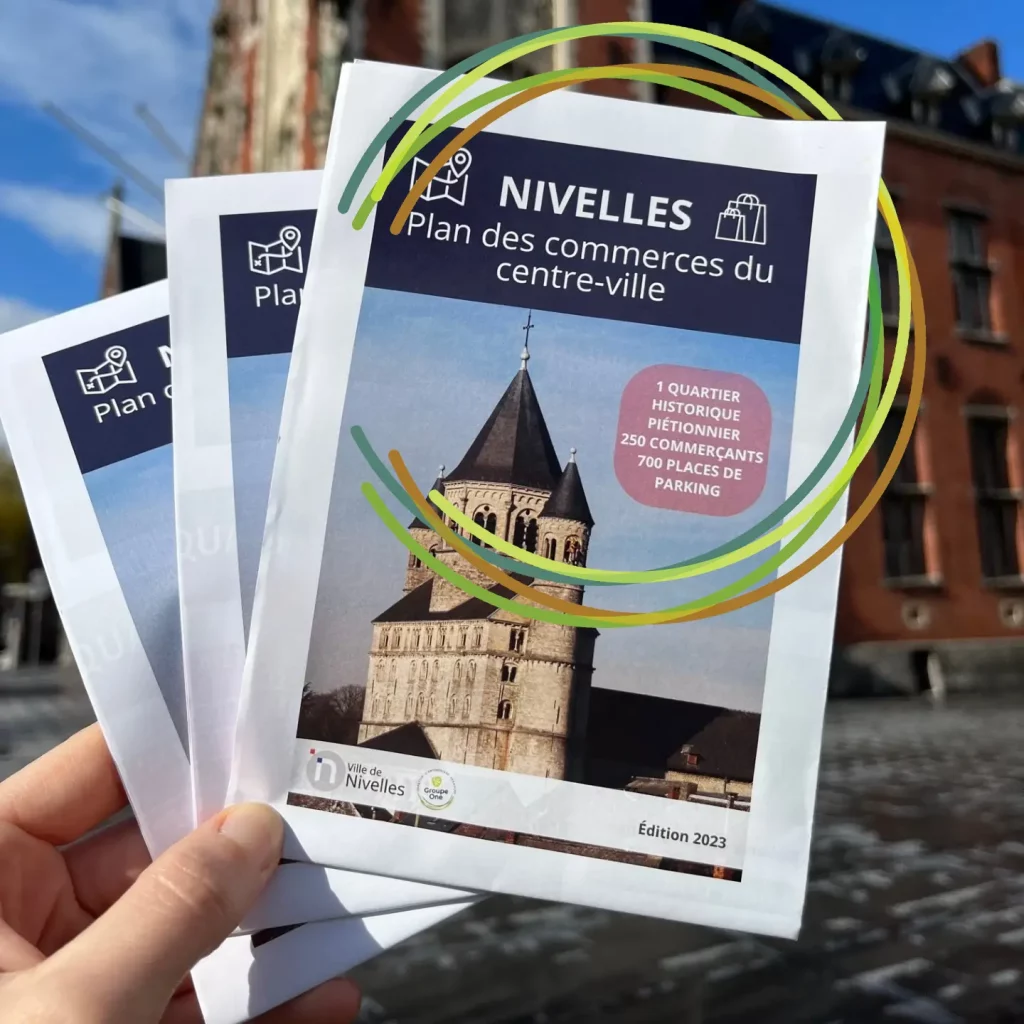 Nivelles, cette charmante ville du Brabant Wallon, célèbre pour sa magnifique collégiale, attire beaucoup les visiteurs avec son charme pittoresque et son ambiance accueillante. Cependant, son centre-ville souffre depuis quelques temps d’un manque de dynamisme commercial : certains types de commerces sont absents, les offres de parkings sont peu visibles et les clients lui préfèrent le centre commercial excentré.
Nivelles, cette charmante ville du Brabant Wallon, célèbre pour sa magnifique collégiale, attire beaucoup les visiteurs avec son charme pittoresque et son ambiance accueillante. Cependant, son centre-ville souffre depuis quelques temps d’un manque de dynamisme commercial : certains types de commerces sont absents, les offres de parkings sont peu visibles et les clients lui préfèrent le centre commercial excentré.



